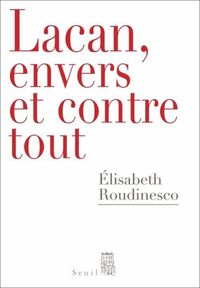Lacan, avec sa quête inlassable de vérité. Que n’a-t-on pas dit sur Jacques Lacan (1901-1981) ? Tour à tour charlatan, tyrannique chef de secte, oracle énigmatique aux écrits indéchiffrables… Elisabeth Roudinesco dissipe ces chimères et restitue vigoureusement le tranchant incomparable d’une parole peu suspecte de frayer avec l’idéologie. Au-delà d’un Lacan qui dénonçait déjà un hédonisme sans limites, une montée de la xénophobie et une haine simpliste de la pensée, l’auteur invite le lecteur à un « vagabondage dans des sentiers méconnus » : un Lacan critique de la famille asphyxiante, explorateur de l’absolue singularité féminine, adepte sceptique et lucide de la Raison et grand collectionneur de livres et d’objets. Le psychanalyste enseigna à ne jamais céder sur son désir, à se battre et se débattre pour devenir soi.
Trente ans après
Depuis la publication, en 1993, de la troisième partie de mon Histoire de la psychanalyse, entièrement consacrée à la pensée, à la vie, à l’oeuvre et à l’action de Jacques Lacan, j’ai souvent eu le sentiment qu’il me serait un jour nécessaire d’effectuer un bilan, non seulement de l’héritage de ce maître paradoxal, mais aussi de la manière dont fut commenté mon propre travail à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté psychanalytique.
Sans doute m’étais-je imaginé à tort qu’un travail serein, fondé sur une approche critique, serait de nature à apaiser les passions. Et que peut-être la célèbre phrase de Marc Bloch – « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce : par pitié, dites-nous, simplement, quel fut Robespierre ! » – que j’avais placée en exergue de mon livre permettrait enfin que soient envisagés, à l’écart des passions, tant la destinée de l’homme que le développement de sa pensée.
Si le résultat fut en grande partie positif, il est évident que l’homme et son oeuvre continuent aujourd’hui de faire l’objet des interprétations les plus extravagantes en un temps où chaque génération a tendance à oublier ce qui s’est passé avant elle, quitte à célébrer l’antériorité patrimoniale et généalogique d’un prétendu « âge d’or » en lieu et place d’une réflexion sur le passé susceptible d’éclairer l’avenir.
A quoi s’ajoutent les délires qui se font jour périodiquement et qui émanent de pamphlétaires peu scrupuleux ou de thérapeutes en mal de notoriété : Freud nazi, antisémite, incestueux, criminel, escroc. Lacan pervers, bête fauve, maoïste, violeur, chef de secte, escroc, tabassant ses femmes, ses patients, ses domestiques, ses enfants, collectionneur d’armes à feu. Tout a été dit à ce sujet et la rumeur se porte bien, de su- renchère en surenchère.
Notre époque est individualiste et pragmatique. Elle aime l’instant présent, l’évaluation, le déterminisme économique, les sondages, l’immédiateté, le relativisme, la sécurité. Elle cultive le rejet de l’engagement et des élites, le mépris de la pensée, la transparence, la jouissance du mal et du sexe pervers, l’exhibition de l’affect et des émotions sur fond d’explication de l’homme par ses neurones ou ses gènes. Comme si une causalité unique permettait de rendre compte de la condition humaine. La montée du populisme en Europe et la séduction que celui-ci exerce sur certains intellectuels prônant ouvertement le racisme, la xénophobie et le nationalisme ne sont sans doute pas étrangères à cette situation.
Il faut dire que l’avènement d’un capitalisme sauvage a contribué à l’extension planétaire de la désespérance et de la misère, associée à la réactivation du fanatisme religieux qui tient lieu, pour certains, de référence politique et d’expérience identitaire. En France, huit millions de personnes souffrent de troubles psychiques et ils se soignent comme ils peuvent : médicaments, thérapies diverses, médecines parallèles, cures en tout genre, développement personnel, magnétisme, etc. Partout dans le monde démocratique, des procédures de médecine de soi se développent à l’infini, à l’écart de la science et, le plus souvent, de la raison. Dans ce monde-là, la quête du plaisir – et non pas du bonheur collectif – s’est substituée à l’aspiration à la vérité. Et comme la psychanalyse est tenue à la recherche de la vérité de soi, elle est entrée désormais en contradiction avec cette double tendance à l’hédonisme, d’une part, au repli identitaire, de l’autre.
Mais du même coup, notre époque produit aussi la contestation de ce qu’elle met en scène : c’est quand le péril est le plus grand, disait Hölderlin, que le salut est le plus proche1 – comme l’espoir d’ailleurs. La preuve : après trois décennies de critiques ridicules contre l’idée même de révolte, voilà qu’émerge, hors de l’Europe qui l’avait vu naître, un nouveau désir de Révolution.
S’agissant de l’histoire de la psychanalyse et de son historiographie, tout se passe donc, après coup, et dans un tel contexte, comme si, malgré l’établissement rigoureux des faits et l’exploration de plusieurs vérités aux multiples facettes, Lacan – après Freud, d’ailleurs, et tous ses successeurs – était toujours regardé tantôt comme un démon, tantôt comme une idole. D’où un manichéisme et un déni de l’histoire. Et les psychanalystes ne sont pas en reste : jargon, posture mélancolique, fermeture aux questions sociales, nostalgie. Ils préfèrent la mémoire à l’histoire, le ressassement à l’établissement des faits, l’amour des temps anciens à celui du présent. Ils oublient volontiers que « demain est un autre jour ». Au point qu’on peut se demander s’ils ne se conduisent pas parfois comme les ennemis de leur discipline et de leur héritage.
C’est en faisant ce constat, et tout en observant les prémices d’une nouvelle espérance, que j’ai eu envie, trente ans après la mort de Lacan, alors que se profile l’évanouissement progressif d’une certaine époque (dite « héroïque ») de la psychanalyse et que les psychanalystes se transforment en psychothérapeutes organisés en une profession réglementée par l’Etat, de parler autrement, et de façon plus personnelle cette fois, du destin du dernier grand penseur d’une aventure intellectuelle qui avait commencé à déployer ses effets à la fin du XIXe siècle, à l’époque du lent déclin de l’Empire austro-hongrois et de toutes les institutions qui y étaient attachées : la famille patriarcale, la souveraineté monarchique, le culte de la tradition, le refus de l’avenir.
J’ai voulu évoquer, à l’intention du lecteur d’aujourd’hui, quelques épisodes marquants d’une vie et d’une oeuvre à laquelle toute une génération a été mêlée, et les commenter avec le recul du temps, de façon libre et subjective. Je voudrais que ce livre soit lu comme l’énoncé d’une part secrète de la vie et de l’oeuvre de Lacan, un vagabondage dans des sentiers méconnus : un envers ou une face cachée venant éclairer l’archive, comme dans un tableau crypté où les figures de l’ombre, autrefois dissimulées, reviennent à la lumière. J’ai voulu évoquer par bribes un autre Lacan confronté à ses excès, à sa « passion du réel2″, à ses objets : en un mot, à son réel, à ce qui a été forclos de son univers symbolique. Un Lacan des marges, des bords, du littéral, transporté par sa manie du néologisme.
Ce Lacan-là a su annoncer les temps qui sont devenus les nôtres, prévoir la montée du racisme et du communautarisme, la passion de l’ignorance et la haine de la pensée, la perte des privilèges de la masculinité et les excès d’une féminité sauvage, l’avènement d’une société dépressive, les impasses des Lumières et de la Révolution, la lutte à mort entre la science érigée en religion, la religion érigée en discours de la science, et l’homme réduit à son être biologique : « Nous allons être submergés avant pas longtemps, disait-il en 1971, de problèmes ségrégatifs que l’on appellera le racisme et qui tiennent au contrôle de ce qui se passe au niveau de la reproduction de la vie, chez des êtres qui se trouvent en raison de ce qu’ils parlent, avoir toutes sortes de problèmes de conscience [...]3. »
Reparler de Lacan trente ans après sa mort, c’est aussi se souvenir d’une aventure intellectuelle qui tint une place importante dans notre modernité, et dont l’héritage reste fécond quoi qu’on en dise : liberté de parole et de moeurs, essor de toutes les émancipations – les femmes, les minorités, les homosexuels -, espoir de changer la vie, la famille, la folie, l’école, le désir, refus de la norme, plaisir de la transgression.
Suscitant la jalousie des clercs qui ne cessent de l’insulter, Lacan se situa pourtant à contre-courant de ces espérances, tel un libertin lucide et désabusé. Certes, il était convaincu que la quête de la vérité était la seule manière de parvenir à substituer le progrès au salut, les Lumières à l’obscurantisme. A condition toutefois, disait-il, de savoir que la rationalité peut toujours se retourner en son contraire et susciter sa propre destruction. D’où sa défense des rites, des traditions et des structures symboliques. Ceux qui le rejettent aujourd’hui, en faisant de lui ce qu’il ne fut jamais et en l’affublant de l’étiquette infamante de « gourou » ou de « pourfendeur de la démocratie », oublient qu’il s’immergea de plain-pied, contre lui-même parfois, dans ces transformations. Au point d’en épouser les paradoxes par ses jeux de langage et de mots que nous nous plaisons aujourd’hui à pratiquer. Le XXe siècle était freudien, le XXIe siècle est d’ores et déjà lacanien.
Lacan n’a pas fini de nous étonner.
Né au début du XXe siècle, et ayant vécu deux guerres féroces, il commença à être célébré dès les années 1930. Mais c’est entre 1950 et 1975 qu’il exerça son plus puissant magistère sur la pensée française, à une époque où la France, dominée par un idéal social et politique hérité des deux mouvements issus de la Résistance, le gaullisme et le communisme, puis par la décolonisation, et enfin par la césure de Mai 1968, se vivait comme la nation la plus cultivée du monde, une nation où les intellectuels occupaient une place prépondérante au sein d’un Etat de droit marqué par le culte d’une République universaliste et égalitaire.
Dans ce contexte, toutes les aspirations fondées sur la raison et le progrès étaient de mise. Et notamment le projet d’améliorer collectivement le sort de tous ceux qui étaient atteints de troubles psychiques : névrosés, psychotiques, dépressifs, délinquants. Et c’est en ces temps-là précisément que Lacan s’obstina à affirmer que l’avancée freudienne était le seul horizon possible des sociétés démocratiques, la seule capable de saisir toutes les facettes de la complexité humaine : le pire comme le meilleur. Il n’en devint pas pour autant, en dépit de son fort penchant pour le pessimisme et l’ironie, un réactionnaire étriqué.
Il fut aussi le seul penseur de la psychanalyse à prendre en compte de manière freudienne l’héritage d’Auschwitz, mobilisant, pour en dessiner l’horreur, tant la tragédie grecque que les écrits du marquis de Sade. Jamais personne, parmi les héritiers de Freud, ne sut, comme lui, réinterpréter la question de la pulsion de mort à la lumière de l’extermination des Juifs par les nazis. Sans cette refonte et sans cette fascination que Lacan éprouva pour la part la plus cruelle et la plus noire de l’humanité, la psychanalyse serait devenue, en France, une piteuse affaire de psychologie médicale, héritière de Pierre Janet, de Théodule Ribot ou, pire encore, de Léon Daudet, de Gustave Le Bon ou de Pierre Debray-Ritzen.
De Vienne à Paris
A mesure que se dessinait, à la fin du XIXe siècle, à la faveur du déclin des souverainetés monarchiques, une nouvelle configuration idéologique fondée sur la peur des foules, l’adhésion à la thèse de l’inégalité des races et la croyance en un idéal de la science susceptible de gouverner les peuples, l’invention freudienne se déployait, au contraire, comme un nouvel humanisme favorisant les libertés individuelles et soucieux d’explorer la part irrationnelle de la nature humaine.
Conservateur éclairé, Freud était convaincu que l’avènement de la démocratie signerait la victoire de la civilisation sur la barbarie. Mais, en bon adepte des Lumières sombres, il était aussi persuadé que cette victoire ne serait jamais acquise et que chaque époque serait toujours menacée, par le progrès humain lui-même, d’un retour permanent de ses pulsions les plus dévastatrices. Autrement dit, il soutenait que la frustration était nécessaire à l’humanité pour contenir son agressivité et ses pulsions sexuelles, mais que celle-ci rendait les hommes malheureux puisque, parmi les vivants, seuls les hommes, à la différence des animaux, étaient habités par un désir de destruction dont ils avaient conscience.
Lacan était plus sombre encore dans son approche de la société humaine, plus marqué, sans doute aussi, par l’idée de la fragilité des régimes démocratiques, plus intéressé par la folie, le crime et la mystique, et finalement plus tourmenté. En un mot, il se distinguait des héritiers de Freud – de Melanie Klein à Donald W. Winnicott et à bien d’autres encore – par la distance qu’il avait prise très tôt vis-à-vis d’une conception de la psychanalyse qui réduisait celle-ci à un corpus clinique.
Freud avait rejeté la philosophie, qu’il compara injustement à un système paranoïaque, pour se tourner vers la biologie, la mythologie, l’archéologie. Lacan fit le chemin inverse en réinscrivant la psychanalyse dans l’histoire de la philosophie et en réintroduisant la pensée philosophique dans le corpus freudien. Par la suite, il voulut faire de la psychanalyse un antidote à la philosophie, une « antiphilosophie », en opposant le discours du maître à celui de l’analyste. Il prit ainsi le risque de rejoindre, contre les Lumières, les suppôts de l’obscurantisme ou des anti-Lumières.
Certes, Lacan était psychiatre et donc clinicien, mais, au fond, il aurait pu devenir autre chose que cela, même si, on l’oublie souvent, il avait une véritable vocation pour la médecine publique. Il ne quitta d’ailleurs jamais l’hôpital Sainte-Anne : « mes murailles », disait-il, quand il prétendait « parler aux murs », souffrant de ne pas être assez entendu. Il y fut interne, puis conférencier, avant de se livrer, au-delà de ce qui est raisonnable, au rituel de la présentation de malades. Et c’est à ce titre qu’il acquit une véritable popularité auprès de milliers de psychologues et de travailleurs de la santé mentale. N’avait-il pas conféré un prestige accru à la thématique des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle, née au coeur de la Résistance, à l’hôpital de Saint-Alban en Lozère, et qui avaient promu une médecine mentale au service du malade et non plus soumise aux classifications archaïques issus de l’ancien ordre asilaire ?
1. »Mais aux lieux du péril croît/Aussi ce qui sauve. » Friedrich Hölderlin, « Patmos » in ?uvres, traduction de Gustrave Roud, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
2. Selon le mot d’Alain Badiou, Le Siècle, Le Seuil, 2005.
3. Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XIX …ou pire (1971-1972), Le Seuil, 2011.
Site: L’EXPRESS, publié le