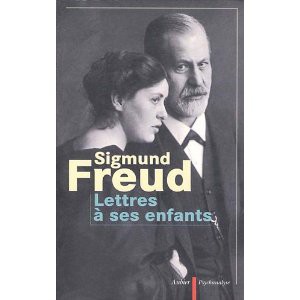Dans les lettres qu’il adresse à ses enfants (et petits-enfants), Freud donne l’image d’un patriarche attentif et aimant
On soupçonne souvent les monstres sacrés d’avoir été de mauvais pères, comme si l’affection naturelle qui porte le parent vers l’enfant devait pâtir de l’engendrement d’une oeuvre. La paternité de Freud fut au contraire l’exemple d’une conciliation possible entre une vie intellectuelle créative et un attachement fidèle à sa nombreuse progéniture.
De sa femme, Martha, épousée en 1886, Freud eut six enfants, Mathilde, Martin, Oliver, Ernst, Sophie et Anna, autant de prénoms choisis en hommage à des personnes chères (pour les filles) ou à des savants admirés (pour les garçons). Si la correspondance de Freud avec sa fille cadette Anna est réunie dans un volume séparé – ce que justifie autant le nombre des lettres que la place particulière que cette enfant occupa dans sa vie -, les cinq autres se lisent comme un agréable ensemble d’où transpire la bienveillance d’un père pour sa descendance. Laquelle, il est vrai, devait connaître un destin tourmenté ; la plupart des enfants de Freud furent affectés par les vicissitudes de l’histoire du XXe siècle débutant – première guerre mondiale, crise de 1929 ou encore prise du pouvoir par Hitler, puis annexion de l’Autriche. La lignée eut aussi à déplorer la perte à l’âge adulte de l’une des siens, la jolie Sophie ; Freud écrit alors qu’il n’y a pas de pire « monstruosité que des enfants doivent mourir avant les parents ».
C’est l’une des choses qui frappent le plus, à la lecture de ces missives généralement assez courtes et immanquablement signées « Papa » : la préoccupation constante de Freud pour la santé des siens. S’il n’a rien pu faire pour Sophie, emportée par la grippe de Hambourg et probablement affaiblie par les restrictions d’après-guerre ni pour le deuxième fils de celle-ci, dont la mort en 1923 l’accable (« jours les plus noirs de ma vie »), ses lettres enjoignent aux uns et aux autres de se reposer et de préserver leur constitution.
Prodigalité
A son fils Ernst, installé comme architecte à Berlin, il adresse une « exhortation pressante à passer cet hiver à Davos ». En cela, Freud use de l’autorité que lui confère son statut de père et dont il ne semble pas avoir douté un seul instant. Autre objet sur lequel Freud se montre inflexible : l’argent. Toute sa vie il a subvenu aux besoins de ses enfants sans imaginer qu’il puisse en être autrement. « Pour moi, avoue-t-il à Sophie en 1917, c’est en ce moment le seul plaisir sans mélange que de pouvoir donner de l’argent à vous, mes enfants, ou à maman ou à tante ; c’est cela seul qui me rend le travail supportable. » Cette prodigalité se traduit dans les correspondances par une large place laissée aux échanges d’argent, comptes ou autres ordres de virement. En 1923, il fait cette remarque à sa belle-fille Lucie, qui sonne si familière, une crise ressemblant fort à une autre : « La conséquence du fait que les jeunes ont aujourd’hui tant de mal à arriver à quelque chose est que les vieux doivent tirer d’eux-mêmes jusqu’à la dernière goutte de leur capacité à produire. »
Ce n’est d’ailleurs souvent que pour regretter le manque de temps qu’il lui laisse que Freud évoque son travail. Non sans humour, parfois : accaparé par des patients anglo-américains, six heures par jour, il bougonne « contre cette satanée nation [qui] n’ouvre pas sa gueule quand elle parle ».
Le psychanalyste, homme de l’écoute, prête l’oreille aux difficultés des uns et des autres, soutenant ici un gendre affecté par une névrose de guerre, éclairant avec franchise Ernestine, la femme de Martin, sur les vraies défaillances de son couple, ou prodiguant là des conseils quand sa fille Sophie lui rapporte les comportements de ses deux garçons, dont l’un n’est autre que le fameux petit joueur à la bobine de fil, cas relaté dans Au delà du principe de plaisir. Objet de la même sollicitude, la seconde génération reçoit de « grand-papa » des envois de timbres et des souhaits d’anniversaire. Faisant part de sa hâte de découvrir un nourrisson, Freud admet avec une lucidité empreinte d’ironie que, tout de même, « il faut un certain temps pour qu’un être de cette espèce apprenne à apprécier la valeur et la fonction d’un grand-père ».
Quelques années plus tard, dans sa dernière lettre à Ernst, qu’il doit retrouver à Londres et alors que le voyage s’organise, le savant, désormais octogénaire, écrit : « Je me compare parfois au vieux Jacob que ses enfants avaient aussi emmené en Egypte à un âge avancé. » C’est donc ainsi que Freud se voyait, patriarche inspirant autour de lui le respect et la piété filiale, figure tutélaire, aimante et aimée.
Site Le Monde – Article paru dans l’édition du 02.11.12